LA
NAISSANCE - LE BAPTÊME |
Au XVIIIème siècle, le baptême a lieu le jour même, (rarement le lendemain de la naissance), à cause de l’importante mortalité infantile à cette époque.
Quand la sage-femme baptise, on dit qu’elle «ondoie», puis le bébé est amené à l’église où le prêtre supplée à la cérémonie.
 |
Quelques enfants ondoyés ont été relevés dans les registres paroissiaux : Le
2 avril 1719 un enfant de Charles HULOT et Charlotte MAILLARD, ondoyé
par Eloy FRERE, tisserand. On trouve dans les registres beaucoup d’enfants « baptisés sous conditions ». (Le 16 septembre 1784, Marie-Geneviève BELLARD et le 4 juillet 1785, Hilarion VINCHENEUX…) |
LE PARRAIN ET LA MARRAINE
C’est la même chose pour Noël, Pâquette, Noëlle, Jean-Baptiste, Martin…
LES JUMEAUX
J’ai remarqué un nombre assez important de jumeaux (ou jumelles), le prêtre écrit alors: «frères (ou sœurs) d’une même ventrée» ou «tout d’une ventrée».
Il y a même eu des «triplés» en 1791, ils ne vécurent que quelques jours (Constant, Luriette et Marie-Madeleine LENOIR).
Et entre 1761 et 1765, il y eut 4 jumeaux : GIROUX, DUPUIS, COTIN et FRERE.
LES PRENOMS
Les prénoms les plus répandus sont :
- pour les garçons : Charles, Claude, Antoine, Louis, Jean, Nicolas, Jacques, François, Adrien…
- pour les filles : Madeleine, Marguerite, Barbe, Marie, Geneviève, Louise, Catherine, Françoise…
du père ou de la mère
LES FILLES – MERES
Quand une fille-mère accouche, elle doit déclarer le nom du père :
En 1704 «est baptisée Françoise, hors de mariage, fille de Pâquette DOURLE laquelle m’a fait dire par la sage-femme en présence des parrain et marraine soussignés, que l’enfant était des œuvres de François MAGUET…»
En 1715, le 8 février sont nées «Louise et Marie-louise MASSE qu’elle nous a déclaré être des œuvres de Louis MOYE, laboureur à Tirancourt, ce qu’elle a d’abondant protesté en la présence de la Dame MACHET, matrone qui l’a accouchée et qui nous l’a certifié…»
LA MORT EN COUCHES
Les nourrices : Quand la maman meurt en couches, le bébé est placé en nourrice, beaucoup de bébés sont en nourrice à La Chaussée-Tirancourt. Souvent, ils sont enfants de bourgeois ou de commerçants d’Amiens.
Le 19 octobre 1719, Jeanne DEVISMES, 40 ans, meurt en couches, son fils Nicolas est mis en nourrice à Belloy, où il décédera le 14 novembre de la même année.
Le 30 novembre 1744, décès de François CHOQUET en nourrice chez Antoine CARPENTIER.
LA MORTALITE INFANTILE
Comme on peut le voir sur le tableau, 27% des morts ont moins d’un an, 48% ont moins de cinq ans.
Quand on a passé l’âge de 12 ans, on est pratiquement «sauvé»; 12% des morts ont plus de 70 ans, les plus vieux ont 85 ans. Il y a eut même un centenaire en 1749 (Jean VASSEUR dont le fils Charles était clerc-laïc).
LES NAISSANCES NOMBREUSES
Entre 1714 et 1728, Jean FOURNY et Marie DADIER ont 7 enfants dont 4 meurent prématurément. Marie DADIER décédera peu de temps après son septième enfant.
François MOYE et Madeleine DEFLANDRE ont 12 enfants en 14 ans, entre 1714 et 1728 (6 meurent avant 10 ans).
Son frère Charles MOYE marié à Madeleine FLAMEN, a 7 enfants pendant la même période.
Charles CUMEL a 6 enfants de 1698 à 1716.
Charles GUIDON et Marie VINCHENEUX ont 14 enfants entre 1704 et 1727. 4 seulement atteindront l’âge adulte.
LES MOIS DE NAISSANCE
|
Courbe
des naissances |
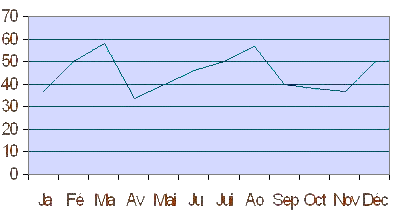 |
Les baptêmes accusent 3 creux. Les conceptions sont moins nombreuses pendant le Carême (avril), les Moissons (août) et l’Avent (décembre).
LES
FIANCAILLES - LE MARIAGE |
LES FIANCAILLES sont «célébrées en notre Eglise à la manière accoutumée», souvent la veille du mariage.
Les bans sont publiés «aux prônes» trois dimanches de suite.
ORIGINE DES EPOUX
|
Années |
Nombre
de mariages |
Les
2 sont de La Chaussée |
Le
mari est de La Chaussée |
La
femme est de La Chaussée |
Aucun |
1709
à 1715 |
36 |
15 |
10 |
9 |
2 |
Près de la moitié des époux sont du village.
Quand l’un des mariés va chercher son conjoint à l’extérieur, il ne va pas bien loin pour trouver son bonheur: Picquigny, Belloy, Yzeux, Saint-Sauveur, Vignacourt, Vaux-en-Amiénois et Argoeuves sont les pays de prédilection.
A 2 reprises, des domestiques en service à La Chaussée se marient, ayant suivi leurs maîtres qui venaient d’ailleurs.
AGE DES EPOUX
Marie-Marguerite DUCROTOY (+ en 1773) se maria 4 fois !
Jean VASSEUR (+ le 4 septembre 1749 âgé de 100 ans), il se maria 4 fois.L'âge des époux
Légende : V veuf; * de La Chaussée; J janvier; Jn juin; Jl juillet; M mai; A août
LES INTERDITS RELIGIEUX
En Décembre (l’Avent) et en Mars-Avril (Le Carême), il est interdit de se marier. Cependant, après accord de l’évêque, les futurs époux peuvent obtenir une «dispense du temps prohibé»; ainsi, en 1714, deux veufs de 40 ans se remarient en décembre, après avoir reçu l’autorisation des autorités ecclésiastiques.
DISPENSES POUR CONSANGUINITE
Dans bon nombre
de cas, la permission de Monseigneur l’Evêque est nécessaire
quand on se marie entre cousins (sines); il faut alors une «dispense
pour 3 ou 4 degrés de consanguinité».
La dispense du Pape est obligatoire pour 2 degrés de consanguinité.
Années |
Nombre
de mariages |
Nombre
de dispenses 3° et 4° |
Dispenses
du temps prohibé |
1709
à 1715 |
36 |
2 |
|
1771
à 1778 |
35 |
5 |
2 |
AUTRES DISPENSES
Quand il y a
urgence, l’évêque peut accorder une «dispense
du troisième ban» ou parfois des «2 derniers bans».
Dispense de «plus ample domicile» : ce fut le cas pour
Pierre Brunet en 1788.
LES MOIS DE MARIAGES
| jan |
fév |
mar |
avr |
mai |
juin |
juil |
août |
sept |
oct |
nov |
déc |
|
1709
à 1715 |
9 |
4 |
0 |
0 |
4 |
2 |
3 |
6 |
1 |
3 |
3 |
1 |
On se marie surtout
en janvier, les périodes d’interdits religieux (Carême
et Avent) sont bien respectées.
Les rythmes annuels des mariages et des naissances sont influencés
en partie par les préceptes de l’Eglise catholique. En effet,
depuis le Concile de Trente (1546-1563), l’Eglise insiste sur le respect
de la Pénitence de l’Avent et du Carême, son influence
sur la population est très importante; la peur de l’Enfer y est
sûrement pour quelque chose.
LE
DECES - L'INHUMATION |
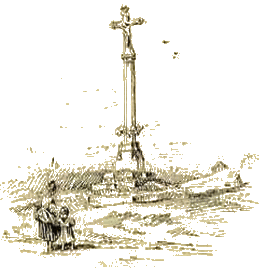 |
Il arrive que des malades soient transportés à «l’Hôtel Dieu» de Picquigny où ils décèdent, tel Louis BEHEN qui décéda le 19 décembre 1737. La cérémonie religieuse de l’inhumation a souvent lieu le jour même du décès, quelquefois le lendemain quand la mort survient durant la nuit. On ne garde pas les corps à cause de l’exiguïté des chaumières et de la peur des épidémies. Le 25 septembre 1772, Nicolas GAVOIS est inhumé le soir même de son décès à cause de sa «corruption» (état de pourrissement avancé). Le 23 mars 1782, la jeune Marie-Jeanne DIOT venant de l’Hôpital des enfants trouvés, atteinte de la «petite vérole», décède, elle est inhumée sur le champ. |
Décès de soldats : Les miliciens
Le 16 avril
1740, Joseph SAGUIER, soldat milicien, décède en «l’Hôpital
Militaire Royal» de Sedan.
Le 11 janvier 1744, Claude HORVILLE décède à Metz.
Le 18 mars 1758, est décédé à l’hôpital
de Bergues* St Evinnoc, François CARON, dit «Saint-Martin»,
milice dans la Bataillon d’Amiens, Compagnie de Goussencourt, natif
de La Chaussée et fils de Jean CARON dit «Po» et de défunte
Barbe LETITRE, suivant l’ extrait du registre mortuaire du dit hôpital.
Signé LECLERC, aumônier et CARLE, commissaire des guerres du
1er Avril.
* il existe un Bergues dans les Flandres où l’on trouve des fortifications
et des monuments anciens et un Bergues dans l’Aisne.
Depuis l’ordonnance
de LUOVOIS, en 1688, chaque paroisse est obligée de fournir en temps
de guerre, des hommes non mariés, de 20 à 40 ans. Ils sont équipés
aux frais de la commune.
A partir de 1760, ces milices sont recrutées par tirage au sort parmi
les célibataires et les veufs sans enfant, de 16 à 40 ans.
Les plus fortunés peuvent se faire remplacer en payant quelqu’un.
En temps de paix, ces miliciens font de courtes périodes dans une garnison
voisine. En temps de guerre, ils sont engagés pour la totalité
des hostilités.
INHUMATION DES NOTABLES
L’inhumation se fait dans le cimetière; cependant, plusieurs personnes aisées sont enterrées dans l’église. Ces inhumations, signe de notabilité, ne seront interdites qu’en 1776.
Le 8 juillet 1720, «Charles CAVILLIER, garçon non marié de 75 ans, autrefois marchand apothicaire à Amiens est inhumé dans l’église comme il a témoigné le souhaiter».
Le 28 février 1716, Charles CUMEL, 48 ans, clerc-laïc, est inhumé dans l’église.
Le 10 novembre 1713, François MOYE, 22 ans, dont les parents sont les fermiers de Monsieur de LESTOCQ, est enterré le 11, jour de la Saint-Martin dans l’église de La Chaussée.
Le 22 février 1713, mourut à Picquigny Monsieur Charles ALLIS, 73 ans, «ci-devant curé de La Chaussée», il fut inhumé le lendemain dans l’église.
Le 27 novembre 1713, est décédé à Tirancourt «Messire Adrien de LESTOCQ, chevalier, seigneur de Beaufort, Termont, Belloy, Rivière et autres lieux, ci-devant Lieutenant des Cent Suisses de feu Monsieur frère unique du Roy, gentilhomme ordinaire de la Chambre, inhumé dans la Chapelle castrale de Tirancourt le 28 et le service chanté au dit lieu le 1er jour de décembre en présence de Messire Nicolas de VILLERS, chancelier seigneur de Bourseville châtelain de Famechon et autres lieux et de Messire François MANNESSIES chevalier seigneur de Guibermainil, ses neveu et petit-neveu…»
Agathe ROUTIER est inhumée dans l’église le 12 juin 1749.
|
Les
mois de décès |
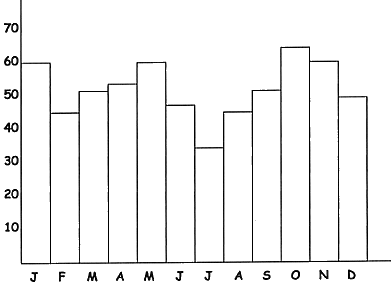 |
Périodes : 1747 – 1760 et 1771 – 1792
J |
F |
M |
A |
M |
J |
J |
A |
S |
O |
N |
D |
Total |
59 |
45 |
52 |
53 |
60 |
44 |
33 |
43 |
51 |
65 |
61 |
48 |
614 |
C’est en
été qu’il y a le moins de décès.
Janvier, mai, octobre, novembre sont les mois où l’on constate
le plus grand nombre de morts.
On meurt surtout à cause d’une absence de soins; seule une forte
constitution physique permet de résister aux épidémies.
En plus du manque de médecine, il y a les époques rigoureuses
où sévissent le froid et la disette (1709, 1718).
La raison essentielle de la mortalité infantile et du décès
lors de l’accouchement est le manque d’hygiène.
|
Baptêmes
- Sépultures - Mariages de 1706 à 1723 |
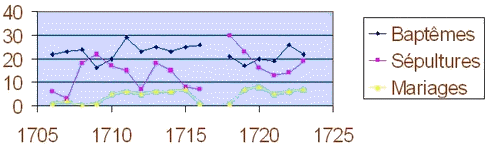 |
|
1706 |
1707 |
1708 |
1709 |
1710 |
1711 |
1712 |
1713 |
1714 |
1715 |
1716 |
1717 |
1718 |
1719 |
1720 |
1721 |
1722 |
1723 |
|
| B |
22 |
23 |
24 |
16 |
20 |
29 |
23 |
25 |
23 |
25 |
26 |
pages
déchi-
rées |
21 |
17 |
20 |
19 |
26 |
22 |
| S |
6 |
3 |
18 |
22 |
17 |
15 |
7 |
18 |
15 |
8 |
7 |
30 |
23 |
16 |
13 |
14 |
19 |
|
| M |
1 |
2 |
0 |
1 |
5 |
6 |
5 |
6 |
6 |
7 |
1 |
1 |
7 |
8 |
5 |
6 |
7 |